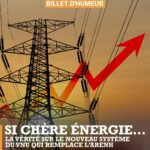Tout au long de la commission d’enquête, ses membres – et à fortiori son rapporteur – ont l’interdiction de formuler des jugements de valeurs ou des analyses sur les éléments factuels recueillis.
En effet, les conclusions de cette instance ne pourront être partagées qu’après délibération de la commission et publication de son rapport, en juillet 2025.
Aussi, les informations ci-après ne sont qu’une synthèse des propos tenus lors des différentes auditions.
Dans le cadre de la commission d’enquête dont je suis rapporteur, nous avons continué le cycle d’audition des grands groupes.
Du 31 mars au 22 avril, nous avons reçu 11 PDG et les avons interrogés sur l’utilisation des aides publiques.
Je vous propose ci-après quelques éléments que j’ai retenus de ces échanges.
Secteur de la grande distribution
Nous avons auditionné Monsieur Bombard, PDG de Carrefour.
En plus des subventions et aides directes diverses, le groupe a été éligible au CICE, pour un montant de 125 millions d’euros par an, et bénéficié depuis de 250 millions d’euros d’allégements de cotisations.
Le PDG a indiqué qu’une majeure partie de ces fonds est affectée au recrutement, à la formation et au pouvoir d’achat des salarié.e.s, le reste est majoritairement investi dans les mécanismes à destination des consommateur.trice.s. Il a précisé qu’il n’y a que peu de suppressions d’emplois ces dernières années, ce qui a occasionné des débats autour de la qualité de l’emploi.
En effet, Carrefour a multiplié les passages de magasins en franchise ou en location-gérance, des modèles sociaux qui font l’objet de vives contestations de l’ensemble des centrales syndicales, qui les considèrent comme synonyme de casse-sociale : un salarié d’un groupe de 110 000 salariés bénéficie de conquis sociaux, dont les bénéfices sont perdus lorsque l’on devient salarié d’une plus petite entreprise.
Secteur énergétique
Nous avons auditionné les représentant.e.s des groupes EDF, ENGIE et ExxonMobil.
Luc Rémont, PDG d’EDF a été parfaitement transparent et a décliné l’ensemble des aides directes et indirectes dont bénéficie le groupe (il faut d’ailleurs constater que de très nombreuses informations étaient disponibles en ligne).
Il a indiqué que pour l’avenir, plutôt que de multiplier les aides et financements divers, la filière énergétique avait surtout besoin de s’adosser à une stratégie d’Etat claire reposant sur des projections économiques solides.
Il considère que la clarté et la stabilité des politiques publiques, notamment sur la décarbonation, doit être une priorité en lieu et place d’octroi aux groupes de fonds ponctuels pour soutenir cette nécessaire transition. En ce sens, il plaide pour la création d’une banque européenne de la décarbonation, qui permettrait d’homogénéiser l’ensemble des politiques des états membres.
S’il estime que les aides publiques peuvent parfois être nécessaires, il alerte sur les tentations d’abonnement.
Comme pour l’audition d’ENGIE, cette commission a été l’occasion d’un débat autour des aides intermédiées, c’est-à-dire à destination des consommateur.trice.s, mais qui sont mises en œuvre par un opérateur : en effet, il peut être considéré que le bouclier tarifaire a également bénéficié aux fournisseurs d’énergie pour augmenter leurs marges, mais cette vision ne fait pas l’objet d’un consensus.
Concernant Catherine MacGregor, DGd’Engie, elle a indiqué que son groupe bénéficie d’aides publiques, qu’elle classe en trois catégories : celles qui sont perçues par son groupe mais reversées, celles conservées et les réductions d’impôts et de cotisations. Elle indique que compte-tenu de la nature du groupe, les aides publiques ne sont sollicitées qu’en cas d’alignement parfait avec les politiques publiques, et en particulier celle de la décarbonation.
Elle considère que les aides ponctuelles pour des projets industriels destinés à engager des solutions énergétiques qui ne sont pas encore assez matures et peu rentables sont essentielles, puisque le groupe ne pourrait s’engager seul.
Pour les aides fiscales et sociales incluant le crédit d’impôt recherche (CIR), cela représente 19 millions d’euros par an et les réductions de cotisations représentent quant à elles 72 millions d’euros.
Des questions salariales restent en suspens, notamment pour les salariés relevant du statut des industries électriques et qui s’apprêtent à subir un plan de restructuration qui courra jusqu’en 2028, avec à la clé une réduction des effectifs de l’ordre de 15 %. A cela, la PDG du groupe ENGIE a répondu en invoquant des arguments de compétitivité et de performance.
Enfin, nous avons auditionné Charles Amyot, PDF d’ExxonMobil France.
En 2023, le groupe indique avoir bénéficié d’un total de 20 millions d’euros d’aides publiques, dont 18,5 millions d’euros concernent des mesures de réduction des coûts pour les industries énergo-intensives (la majorité des aides reçues sont liées à la décarbonation). Le groupe indique faire appel de manière limitée au CIR, qui a représenté environ 1 million d’euros en 2023.
Il indique que le groupe est prêt à accepter des objectifs contraignants en matière de décarbonation, mais pense qu’il serait préférable qu’une liberté de choix des technologies mobilisées soit laissée à l’entreprise.
Je l’ai interrogé sur la fermeture du site de Fos, et l’annonce récente du licenciement de 677 personnes. Il a argumenté en arguant la crise durable dans laquelle s’enfonce le secteur de la chimie en Europe, qu’il considère en fin de cycle, et a justifié cette casse sociale par des efforts de compétitivité.
Secteur de la construction automobile
Nous avons auditionné Jean-Philippe Imparato, DG Europe de Stellantis France, qui indique que son groupe bénéficie de 14 dispositifs d’aides publiques depuis 2013, qui vont d’aides directes aux crédits d’impôts et exonérations de cotisation.
Le montant du CIR, en 2023, représentait 63,2 millions, dont 50,3 millions pour la R&D et 6,3 millions pour le manufacturing. Quant aux allègements de cotisations, ils s’élèvent à 80 millions d’euros en moyenne chaque année – 79 millions sur l’exercice 2022 et 94 millions sur l’exercice 2023 – pour une masse salariale représentant 1,7 milliard d’euros.
Le PDG s’est montré favorable à une stratégie d’aides publiques qui repose sur de véritables objectifs politiques, et serait favorable à réduire leur éclatement pour en augmenter l’impact. Nous avons notamment évoqué le dispositif de « leasing électrique » : si le PDG considère que le principe n’était pas inutile, sa mise en œuvre était complétement inadaptée. Résultat, cela aura coûté 455 millions d’euros aux caisses de l’état, et l’opération a entraîné des difficultés, notamment pour les concessionnaires.
En revanche, j’ai questionné le PDG sur sa politique à l’égard de l’emploi des salariés en sous-traitance, eu égards aux montants d’aides publiques alloués : seuls des impératifs de compétitivité ont été mis en avant, sans argumentation portant sur la responsabilité des donneurs d’ordres.
Secteur nouvelles technologies
Nous avons auditionné les représentants de STMicroelectronics et d’Atos.
Jean-Marc Chery, PDG de STMicroelectronics, n’a pas fait preuve d’une grande clarté lors de notre audition sur l’ensemble des aides publiques perçues…
Concernant le CIR, le PDG a indiqué qu’en 2023, le groupe a reçu 119 millions d’euros de CIR. Lorsque ce chiffre est mis en perspective avec la contribution fiscale et les dépense en R&D du groupe dans notre pays (871 millions d’euros en France), on constate qu’en réalité l’activité de recherche en France est financée à … 55 % par des aides publiques ! Un chiffre qui interpelle, alors qu’en temps normal, les groupes bénéficient un soutien étatique à hauteur de 7 à 10% de l’investissement.
Sur la question sociale, le PDG n’a pas souhaité communiquer d’informations à la commission d’enquête, indiquant que les organisations syndicales doivent être les premières destinataires des intentions de l’entreprise.
Quant à Philippe Salle, le nouveau PDG d’ATOS qui bénéficie de très nombreux dispositifs d’aides publiques et passe beaucoup par de la commande publique, il a indiqué qu’il ne considérait pas le CIR et le CICE (puis les exonérations de cotisations) comme des aides, mais comme des compensations…
Interrogé sur les montants alloués à la R&D par le groupe en France, le PDG n’avait pas de chiffres consolidés, en précisant que le groupe couvrait des pans d’activités très différents qui n’amènent pas les mêmes dépenses.
Il a axé son argumentaire sur les mauvais choix précédemment faits par le groupe (notamment de scinder les activités, sur conseil de Mc Kinsey) qui ont conduit à une réduction des postes, et met en cause la mondialisation et l’ouverture des marchés sur des activités stratégiques pour notre pays ; il a insisté sur la nécessité d’une politique publique ambitieuse de protection de nos actifs stratégiques.
Notre commission s’est attardée sur un choix qui interroge particulièrement, alors que le groupe dispose d’un solide soutien d’état : le récent montage financier du groupe au Pays-Bas pour y loger des actions et réduire la fiscalité sur leur cession. Un montage temporaire, assure Philippe Salle !
Secteur aéronautique
Notre commission a également auditionné les représentants d’Airbus et de Safran.
Le secteur aéronautique civil fonctionne via la commande publique, dont une large partie passe par le CORAC, une instance qui met en relation l’état, les grands groupes et les laboratoires de recherches.
Pour chaque projet initié dans le cadre de cette instance, des conventions sont mises en place et les subventions publiques ne peuvent excéder 50% du montant total (mais il faut, en complément, garder à l’esprit que les salaires des chercheur.euse.s sont très souvent pris en charge par la collectivité puisque ce sont des fonctionnaires).
Concernant Airbus, Guillaume Faury, son PDG, a indiqué qu’en 2023, le groupe avait bénéficié de 159 millions de subvention (dont 150 via le CORAC), 98 millions d’euros de CIR, et de 6,2 millions d’euros d’exonérations de cotisations sociales.
La commission a également questionné la politique du groupe à l’égard des sous-traitants, notamment au moment de la crise du COVID-19 qui avait conduit à la suppression de plusieurs milliers d’emplois. Le PDG considère que les résultats financiers ont été maintenus, et qu’ainsi cette gestion était la bonne.
Concernant Olivier Andriès, PDG de Safran, il a indiqué que le groupe recevait, en moyenne, 160 millions d’euros du CORAC, et 159 millions au titre du CIR qui est selon lui un excellent dispositif d’aide publique puisqu’il participe pour le groupe à conserver 90% des dépenses de R&D sur le sol français.
Il indique également qu’une action de l’Etat serait aussi attendue dans le renforcement de l’enseignement des mathématiques, puisqu’il considère que ce qui fait la force et l’attractivité de notre pays, au-delà des aides publiques, ce sont les compétences des travailleurs et travailleuses.
Le ratio précis de l’abondement des financements CORAC par les deux groupes n’a pas été communiqués à la commission, et devrait être transmis ultérieurement.
Ces deux PDG ont indiqué avoir renoncé à verser des dividendes pendant la période du Covid-19, puisqu’ils ont bénéficié de soutiens de l’Etat pour le maintien de l’emploi.
Ils ont également insisté sur le fait que l’aéronautique est probablement le seul domaine industriel où la France joue un rôle mondial, notamment en matière de décarbonation, parce qu’elle dispose de deux groupes sous pavillon national en pointe.
Enfin, nous avons auditionné François Jackow, DG d’Air Liquide, Xavier Huillard, PDG de Vinci et Jean-François Cirelli, PDG de Black Rock
Concernant Air Liquide, le PDG a indiqué que le groupe bénéficie d’aides publiques, qu’il a classé en 6 catégories : les aides à l’innovation, à la compétitivité (incluant les aides énergétiques), aux activités de santé, à l’emploi et apprentissage, les aides liées à la période Covid, et les déductions fiscales principalement liées à la fondation Air Liquide.
Il considère que le crédit d’impôt recherche (CIR) constitue un levier majeur pour leur stratégie d’innovation, et se chiffre, en moyenne, à 36,4 millions d’euros par an. Les dépenses éligibles sont réalisées à 97 % en France, les 3 % restants étant alloués à d’autres structures dans l’Espace Économique Européen, notamment un centre à Francfort qui bénéficie de l’agrément CIR. Les subventions directes aux projets d’innovation, hors CIR, sont relativement limitées.
Il précise qu’il lui semble impératif que les aides publiques se concentrent sur la définition des objectifs sans imposer les moyens pour y parvenir. Cette approche permet aux entreprises de choisir les solutions technologiques les plus adaptées, évitant ainsi des orientations potentiellement inefficaces à long terme.
Concernant les aides à l’emploi, le groupe bénéficie d’allègements de cotisations sociales à hauteur de 30 millions d’euros, et a touché, entre 2013 et 2018, 12 millions d’euros par an au titre du CICE.
Cela n’a pas empêché des suppressions drastiques de postes, alors que l’activité est porteuse. Interrogé à ce sujet, le PDG n’a pas donné de réelles justifications autre que le maintien d’une certaine compétitivité, alors que le secteur a des perspectives d’avenir !
Concernant le PDG de Vinci, il a indiqué que son groupe perçoit de nombreuses aides publiques, notamment 20 millions d’euros au titre du CIR en 2023, et dont le modèle repose essentiellement sur des partenariats publics privés.
Aussi, cela a animé les débats de notre commission, alors que ce modèle de partenariat a fait l’objet de nombreuses critiques sur le déséquilibre en termes de risques, qui pèsent dans leur immense majorité sur les collectivités publiques !
Enfin, concernant BlackRock, Jean-François Cirelli son PDG, a assuré que les aides publiques ne constituent généralement pas un facteur décisif dans les décisions d’investissement, et qu’elles peuvent au contraire être considérées comme facteur de risque, car elle soulève des questions sur la pérennité et la viabilité à long terme des modèles économiques qui en dépendent.
Il a cependant indiqué qu’il existe des exceptions, notamment dans le secteur des énergies renouvelables.
Cette affirmation, couplée aux indications que BlackRock était totalement favorable à la transparence sur les aides publiques, m’a conduit à le questionner sur le montage particulièrement opaque autour de la société Renner Energie (dont le résultat net est nul), et la galaxie de SAS qui y est rattachée … et qui refusent de rendre public leurs comptes !
A une exception près, la plupart des PDG se sont montrés plutôt favorables au renforcement de la transparence des aides publiques avec l’administration et la représentation nationale, assortie de quelques réserves concernant leurs concurrents.
Sur la question sociale, il est ressorti de chaque audition une mise en parallèle entre aide publique et mondialisation des marchés, qui fait des salarié.e.s, intérimaires et sous-traitants des variables d’ajustement au profit de la compétitivité. Un argument qui semble peu recevable pour certaines catégories d’activités qui restent porteuses malgré une concurrence internationale accrue !
Enfin, de nombreux groupes ont fait valoir le fait que les aides publiques devaient être adossées à une véritable stratégie politique, en lieu et place de mécanismes ponctuels et éclatés.