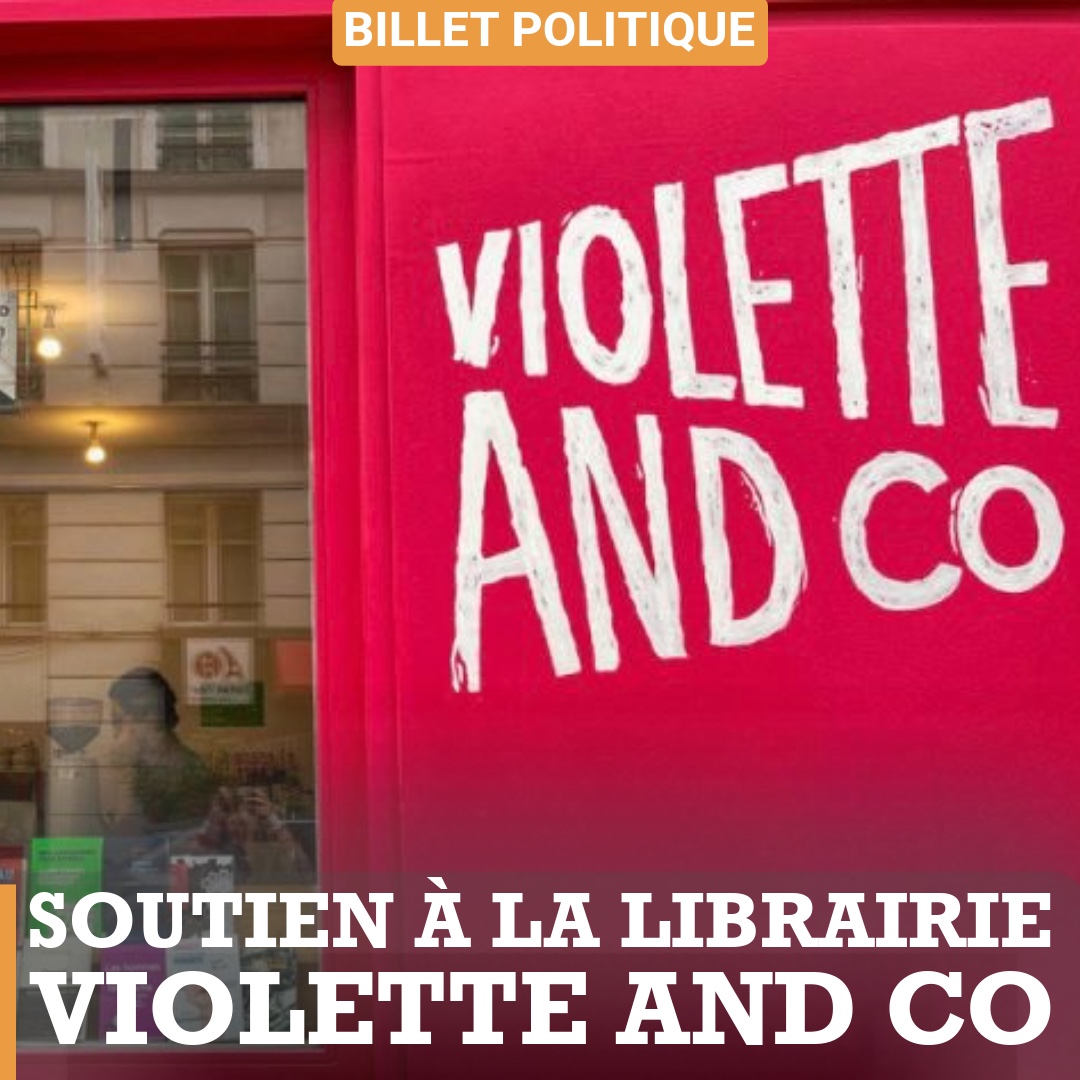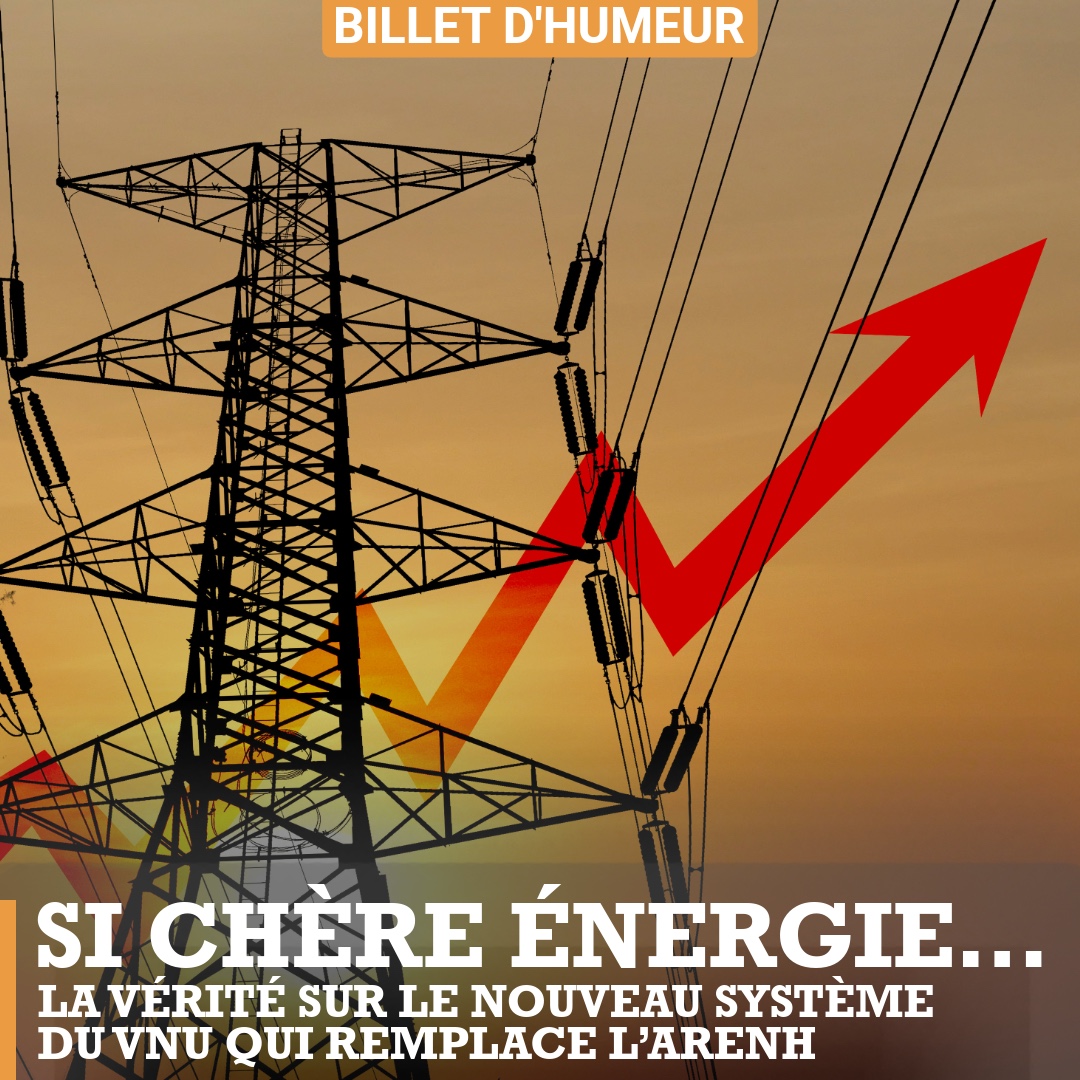Alors que nos yeux sont rivés sur le génocide en cours à Gaza et sur la guerre interminable en Ukraine, nous n’oublions pas nos frères et sœurs kanaks, un an après les émeutes faisant suite au projet de loi constitutionnelle sur le dégel du corps électoral. Pendant plusieurs mois, un profond mouvement de révolte avait secoué le Caillou, faisant quatorze morts, à la hauteur de la colère ressentie face au mépris de l’histoire de l’archipel. Nous n’oublions aucun d’eux et sommes solidaires des familles endeuillées. Ce texte, porté par la majorité présidentielle avec le soutien des forces de droite et de l’extrême droite, actait de façon unilatérale la fin du processus inédit de décolonisation dans cette région française du Pacifique et la fin de trente années de paix, chèrement acquise. En repoussant les élections provinciales et en changeant le corps électoral au profit d’une population issue de la métropole, Macron et le gouvernement avaient provoqué un retour en arrière sans précédent et une remise en cause des accords de Matignon et de Nouméa.
Ces accords, inscrits dans la Constitution, reconnaissent le droit du peuple kanak et les violences subies durant la colonisation française. Le gel du corps électoral et une forte autonomie locale avaient permis de rééquilibrer les droits avec la population caldoche. Cela constituait le début d’une véritable décolonisation pour ne pas rendre minoritaires les Kanak dans les choix d’avenir, dont celui de l’indépendance. Malgré de réelles avancées politiques et sociales depuis 1988, les Kanak restent structurellement discriminés et marginalisés économiquement. Le poids du colonialisme reste prégnant avec des inégalités et des fractures en fonction de l’origine. La colère de la jeunesse kanak est le symptôme de cet héritage malgré les conquêtes démocratiques et sociales de leurs aînés.
Durant les révoltes du printemps dernier, certains militants politiques ont payé très cher leurs actions pour revendiquer l’indépendance, à l’instar de Christian Tein, porte-parole du CCAT (Cellule de coordination des actions de terrain), toujours emprisonné à Mulhouse, comme plusieurs de ses camarades de combat, victimes d’une répression judiciaire coloniale, qui les a expulsés vers l’Hexagone, loin de leur famille et de leurs racines. Nous continuons à exiger leur libération immédiate. Il faut relever le changement de méthode du nouveau ministre des Outre-Mer, salué par toutes les forces en présence. À base d’écoute et de dialogue, à l’inverse du passage en force de ses prédécesseurs, Manuel Valls mène sa mission de façon respectueuse des enjeux locaux, respectueuse du peuple premier. Il a pris conscience du poids de la question coloniale et de la légitimité d’accéder à la pleine souveraineté et de garantir le droit à l’autodétermination.
L’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie-Kanaky est en train de se jouer après un 3e référendum bâclé et saboté par les autorités. Même si pour l’heure les négociations ont échoué, il faut poursuivre pour trouver une issue. Après ceux de Matignon et Nouméa, cet accord serait historique et marquerait enfin une étape pour la société néo-calédonienne vers une issue de paix et de réconciliation, tournant définitivement la page de la domination passée. L’heure est à la reconnaissance pleine et entière de l’identité kanak et de ses spécificités, de ses terres, de son patrimoine. Un futur accord doit être un pas de plus sur le long chemin vers la décolonisation et celui d’un destin commun, celui de l’espoir de vivre un jour, en liberté, dans un archipel apaisé.